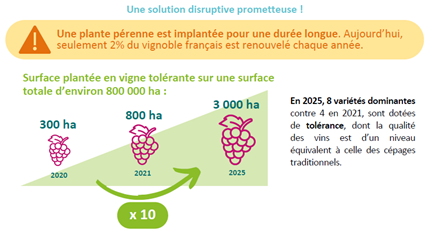La solution
Figurent au Catalogue Officiel 21 anciens hybrides de cuve dont 2 sont réservés à la distillation (Baco blanc et Vidal blanc). Ces variétés, aussi appelées Hybrides Producteurs Directs (HPD) ont été obtenues à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, en réponse à l’arrivée dans les années 1860 en Europe de bois et de plants d’origine américaine porteurs de l’oïdium, du mildiou et du phylloxera. Ces variétés sont considérées comme tolérantes, ne nécessitant que peu d’interventions phytosanitaires mais elles sont de qualité globalement très moyenne (jugées parfois trop acides, tanins durs, arômes superficiels …), et d’un point de vue réglementaire, ne permettent de produire que des vins de France (ex. vins de table), à l'exception notable du Baco blanc, inclus dans l'AOP Armagnac, mais dont le vin est distillé et non consommé tel quel. Le Vidal blanc est également en expérimentation à Cognac (VIFA). Néanmoins leur utilisation permet d’envisager une réduction de l’usage des produits fongicides.
Plus récemment se sont développés des programmes d’hybridation interspécifiques. Ces programmes ont généré l’obtention de variétés, dont 16 sont classées aujourd’hui en France. Le classement permet la vinification et la commercialisation des vins.
Il est clair que la forte proportion d’appellations d’origine ainsi que le succès mondial des vins français à partir des cépages emblématiques historiques ont sans doute été un frein aux initiatives de création variétale en France. Ce n’est qu’en 1974 que les travaux ont été repris par l’INRAE, en l’occurrence par Alain Bouquet.
Ces variétés ont été sélectionnées pour être plus « qualitatives » que les anciens hybrides. Cependant, la grande majorité ne contiennent qu’un facteur (ou gène) de résistance. Or les populations de mildiou et d’oïdium s’adaptent et des cas de contournement de la résistance ont été recensés chez ce type de variété. Dans ce cas, la variété se comporte comme une variété sensible malgré la présence de ses résistances qui ne reconnaissent plus le pathogène.
Ainsi en France, au début des années 2000, l’INRAE a relancé des travaux s’appuyant d’un côté sur les recherches d’Alain Bouquet et d’un autre côté sur les variétés obtenues en Allemagne. Ces travaux sont conduits selon les mêmes méthodes d’hybridation classique que celles utilisées au 19ème siècle pour l’obtention des HPD (programme INRAE-ResDur pour ‘résistance durable’). 4 variétés à résistance polygénique car contenant 2 facteurs de résistance majeurs au mildiou et également 2 facteurs de résistance à l’oïdium, ont été autorisées à la culture en France en 2018. L’objectif est d’avancer toujours vers des vins qualitatifs mais aussi de garantir « une résistance durable ».
Ces innovations doivent permettre de réduire significativement les traitements et de proposer des vins de qualité. En ce qui concerne les variétés Resdur, l’INRAE et l’IFV recommandent toutefois un nombre minimum d’interventions pour protéger durablement l’efficacité des facteurs de résistances et empêcher le développement de maladies fongiques qui ne sont pas la cible des gènes de résistance (ex. Black rot), 2 en moyenne mais cela pourra varier en fonction des conditions pédoclimatiques.
Actuellement d’autres variétés résistantes sont en cours d’évaluation en vue d’une prochaine inscription au Catalogue officiel (voir Dynamique d’inscription).